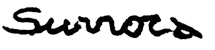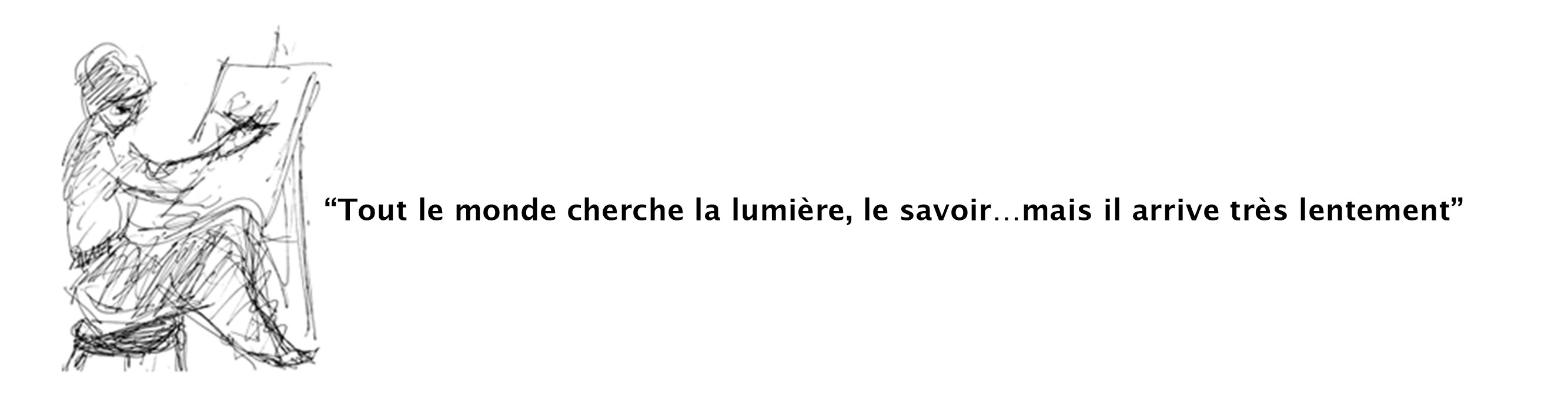18.07.1936
Quand la guerre éclata, je pris la route vers Paris car je considérais que pour un thème politique, je ne voulais pas me brouiller ou faire la guerre à mes amis ou mes frères. Je reconnais qu'il n'y a là aucun acte héroïque, partir sans avoir choisi mon camp, mais il n'était pas recommandable de se mettre à servir un camp ou un autre, car ils portaient le visage de la dictature. C'était le fascisme ou le communisme et comme je l'ai déjà dit: " Pour moi, aucun des deux ne m'intéressait".
Par conséquent, un dimanche comme un autre, ça devait être le 22 ou le 24 juillet, je suis allé faire mes adieux à mes parents et mon frère, emportant uniquement un cahier pour dessiner, avec l'excuse d'aller prendre des notes je pus passer le premier contrôle de l'armée, des miliciens qui me connaissaient déjà et qui étaient à la sortie de Camprodon. J'ai eu un peu peur, parce que, comme on peut l'imaginer, je n'avais pas de valise, et, s'ils ne m'avaient pas laissé passer…
Je portais deux chemisettes, deux chemises, deux pulls, ma veste, deux pantalons et aussi le manteau, tout cela sur moi, ça, c'était ma valise!
Après avoir, passé le contrôle, je pénétrais dans un défilé de montagnes et, sans m'arrêter, en passant par des chemins impraticables, j'arrivais à l'aube à la frontière française, dans un petit village nommé Fabert. De là, je pris chemin vers Prats de Mollo. Tout ça, je l'ai fait en marchant.
Dès mon arrivée à Prats de Mollo, je me suis rendu à la police française, ils m'ont fiché puis je suis parti à Perpignan en autobus.
Au bout de deux jours, la police m'attrapa et me fit interné dans un camp de concentration à Montpellier. Quand j'étais là renfermé, un policier est venu demander si quelqu'un savait parler le français. Moi, je connaissais la langue, on m'a donc utilisé comme interprète pour faire la filiation de tous ceux qui étaient entrés ce jour-là, nous étions plus d'une quarantaine.
À la fin, j'étais devenu ami du préfet et trois jours plus tard, il m'appelait pour me dire: "Si tu as la possibilité de partir vers Paris où n'importe où ailleurs, pars ce soir. Parce que demain, il sera déjà trop tard!"
Le jour suivant, ils les enverraient de nouveau tous en Espagne. En les laissant choisir de quel côté ils voudraient être. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai repris mes pauvres affaires et je suis parti vers Paris, en train, de Montpellier.
C'est comme ça que commença mon aventure parisienne, sous la forme d'un exil.
À peine descendu du train, je partis vers la maison d'un parent, le sculpteur Joaquim Claret, fils de Camprodon qui me reçu très bien et m’offrit son foyer. Je travaillais avec lui dans l'atelier de sculpture et cela me permis de continuer avec l'art. Là-bas, je fis connaissance et me liai d'amitié avec des peintres, des sculpteurs, des poètes…Et même des sportifs! C'est pour cela que j'ai commencé à jouer dans l'équipe de Saint Germain. J'avais toujours beaucoup aimé jouer au football.
Pendant mon séjour, il y eut l'exposition Internationale de Paris, où je pus admirer le célèbre tableau de Picasso, Guernica. C'était impressionnant! Permettez-moi de vous expliquer brièvement sa situation: Le Pavillon Espagnol, ou, pour utiliser les mots justes, le pavillon de la Généralité de Catalogne était le plus petit et insignifiant de tous ceux de l'exposition, mais ce fut l'un des plus visités. Nous devons tenir compte que les uniques choses qui sont restées après cette exposition sont: Guernica de Picasso, La Ferme de Miró, La Fontaine de Mercure de Calder, Montserrat de Julio González, tous venant du petit pavillon espagnol.
Le cadre de Guernica est un chant à la tragédie qu'a souffert la ville suite aux bombardements criminels des Allemands, qui leur ont servi d'essai pour la Deuxième Guerre Mondiale qu'ils étaient en train de préparer. Picasso, en se chargeant de faire la commande, s'inspira de ce haut fait pour dénoncer d'une manière terrifiante ce qu'ont été ces bombardements criminels qui n'ont rien respecté. Ni femmes, ni enfants…
Dans son tableau, on peut voir de manière terrifiante la souffrance, la peur, l’horreur représentée par des bêtes en agonie, expliqué en morceau ou en partie comme si en cet instant précis venaient d'éclater les bombes qui ont détruit un village innocent, pris au dépourvu, sans aucun moyen de se préparer ou se défendre.
Tout dans ce cadre est agoni, femmes, chevaux, enfants…On dirait qu'ils crient tout ce qui leur arrive. Picasso a capté tous les sentiments du village espagnol qui était situé dans la partie qui n'était pas dominée par le fascisme. Picasso a promis de ne pas retourner en Espagne tant que Franco gouvernerait. Et, il a tenu sa promesse. Et pourtant, on lui demanda de rentrer à maintes reprises, et lui jamais n'a cédé.
Il y avait aussi Pau Casal, considéré comme le meilleur "Blond" du monde entier, qui se retrouva dans les mêmes circonstances que Picasso, exilé et ne pouvant rentrer dans sa chère Catalogne, pour cela les concerts qu'il donnait chaque année dans l'église de Saint Pierre seraient célèbres, dans ce petit village nommé Prades, situé de l'autre côté des Pyrénées.
Quand j'étais en exil, à Paris, mes parents et mon frère étaient dans la zone des Républicains. Eux, ils n'ont pas dû partir à la guerre, les uns pour être trop vieux, et l'autre trop jeune. Si j'étais resté, j'aurais dû partir. Je communiquais avec eux par courrier écrit pour avoir des nouvelles. Dans mes lettres, je devais faire semblant d'être une fille, je disais que j'étais ma cousine. Que j'étudiais les Beaux Arts dans l'atelier d'un de mes amis, que nous nous réunissions de temps en temps pour dessiner dans son atelier. Que lors d'une des sessions, on a fait des photos de groupe et comme il y avait une fille au milieu du groupe, je leur fis voir que cette fille c'était moi, ma cousine. Je pus envoyer la photo chez moi pour qu'ils me voient, chose qui les remplirent d'émotion.
C'est lors de mon séjour à Paris que s'épanouit pleinement mon illusion de pouvoir être entre artistes de renoms, avec qui je pus exposer une petite œuvre, dans une exposition collective, et comme l'avait dit la critique, j'en étais le benjamin.
Des noms comme Maurice DENIS, André DERAIN, Maurice UTRILLO, Aristide MAILLOL…(Un des meilleurs sculpteurs du monde selon mon oncle) et beaucoup d'autres faisaient partie de cette exposition. Pouvez-vous vous rendre compte du plaisir que j'éprouvais? Cette exposition fut inaugurée le 22 décembre 1938 et se termina le 5 janvier 1939.
Hormis cela, il y avait aussi le fait d'assister aux cours de l'Académie de la Grande Chaumière qui était un repaire bohémien très prestigieux pour ce qu'était alors Paris. En ce lieu, je fis connaissance avec beaucoup de gens, dont un chef de police! Une rencontre qui m'a été bien utile…De suite, je vous expliquerai pourquoi.
Je jouais au football, avec le Paris Saint Germain, et, je n'avais pas trop d'argent, et un jour, un de l'équipe me dit: "Toi qui danse si bien, pourquoi tu n'irais pas à cette Académie et de cette façon, tu pourrais te renflouer les poches…" Et, aussi tôt dit, aussi tôt-fait, c'est ainsi que je me présentai, la même après-midi, et ça fonctionna. Ils m'ont dit: "tu commences cette nuit". Ils m'ont mis un smoking et ils m'ont dit: "Quand une dame ou une demoiselle viendra te chercher pour danser, elle te donnera un ticket pour chaque danse. Ticket gagné, commission pour toi". En résumé, je faisais un peu le gigolo.
Par chance ou malchance, cette aventure ne dura qu'une nuit, la police apparut à peine avions-nous commencé et nous arrêta tous. Ici vient l'épisode de chance que je vous disais, d'avoir connu le chef de police de Paris, Monsieur de Orner. Quand il me vit, il me demanda ce que je faisais là. Je lui répondis qu'il y avait seulement dix minutes que j'avais commencé mon nouveau travail et que déjà j'étais un détenu. Alors il me dit: "Sors, allez sors d'ici, pars de cette maison, elle n'est pas faite pour toi…Et si tu ne pars pas je serai obligé de t'arrêter".
Quelle chance! Mais cette histoire n'est qu’une parmi tant d'autres qui se passèrent lors de mon exil à Paris. Il y en a d'autres.
Un beau jour, j'appris que, dans une ancienne demeure de nobles, on avait besoin d'un jardinier. Et, je me suis présenté pour ce travail. Dans cette demeure, vivaient deux vieilles dames très affables, qui directement me trouvèrent sympathique et avec lesquelles j'établis une bonne relation d'amitié. Elles m'expliquaient ce que je devais faire, soit, arracher les mauvaises herbes des chemins du jardin. De suite, elles virent mon manque d'expérience dans le domaine, car, à peine après avoir parcouru quelques mètres, j'avais déjà creusé d'un mètre de profondeur le chemin. Évidemment, elles l'ont remarqué de suite et m'ont dit que de jardinerie, j'en savais bien peu. Malgré tout, il en est resté une jolie amitié. Pendant ce temps, je leur expliquais le motif de ma présence, l'Art. Dès qu'elles l'ont su, elles m'ont montré toute la demeure, une maison splendide avec les écuries toujours avec leurs vieux chars et puis les salons avec leurs dessins et peintures magnifiques, parmi lesquelles il y avait un dessin à la plume de Delacroix. Quant elles virent mon engouement, elles décidèrent de me faire un cadeau. C'était un format assez grand. Je ne pouvais accepter, d'aucune manière. Je ne pouvais pas profiter de ces grandes Dames qui s'étaient si bien comportées avec moi.
Une nuit, début 1939, j'étais en train d'écouter la radio et j'eus la plus grande peur de ma vie. Le communiqué de guerre était donné, ils disaient qu'on avait bombardé Camprodon. J'ai pensé que mes parents étaient morts, ils vivaient au centre du village. Dieu merci, il n'en fut rien ainsi, les bombes, qu'il s'agisse ou non d'une erreur, sont tombées sur un village proche, à Saint Paul de Seguries. La cause de ce bombardement fut que la plus grande partie du Gouvernement, de ce qui s'appelait la République, résidait à Camprodon. Un d'eux, le président Docteur Negrin.
Alors que j'étais encore à Paris, on annonçait le retirement des troupes, c'était mi-février, en plein hiver. Après que de nombreuses localités furent conquises par l'armée rebelle.
La fin de la guerre se rapprochait de jour en jour. Après la chute de la Catalogne, le gouvernement de la République avec Negrin comme président, la zone centrale déménageait, bien qu'ils la contrôlassent toujours. Les habitants qui s'étaient fait remarquer du côté Républicain s'exilaient, la plupart d'entre eux, à pied. Les pauvres, ils les ont bien trompés! Ils crurent que la route de la frontière arrivait à Prats de Mollo, ce qui était loin d'être vrai.
Ils trompèrent tout le monde, en disant que la route de Camprodon menait à Prats de Mollo, qu'on venait de finir de construire cette route et qu'on pouvait y circuler correctement. Que des mensonges! On pouvait uniquement arriver à Mollo par une route provinciale. Ils durent marcher beaucoup, accompagnés de la neige et du froid, afin de pouvoir arriver à la frontière. La procession de gens qui passaient par les rues du village à destinations inconnues dura plusieurs jours.
Dans ces montagnes, quand se terminait le tronçon de route, les voitures ne pouvaient plus continuer, et alors, elles étaient précipitées vers des ravins, qui devenaient tous des contrées remplies de voiture. Avec ces voitures, une fois la guerre terminée, il eut un grand commerce duquel ressortait une espèce de mafia qui les appelait "ceux de seconde main". Le travail consistait en enlever les pièces réutilisables des automobiles jetées, puisque ce qu'il manquait à Barcelone et dans tous les garages, c'étaient des pièces de voitures pour faire des réparations, il était impossible d'en avoir à cause du blocus des autres nations.
La plupart des gens, par peur des représailles que pouvait faire le régime de Franco, partaient, effrayés, vers la frontière française (comme dit précédemment), l'unique endroit qu'il y avait pour échapper à tous ceux qui avaient fait la guerre ou s'étaient démarqués d'une manière ou d'une autre. Ceux qui étaient arrivés à Coll d'Ares (point de frontière) étaient détenus par l'armée française, désarmés et emprisonnés dans des camps de concentration qui s'ouvraient sur les plages d'Ares, Ceret et autres. Tous vivaient au plus bas, c’est-à-dire, sans aucun refuge et c'étaient pour eux un véritable enfer.
Mes parents, eux, à la fin de la Guerre (1er avril 1939) partirent se réfugier à la montagne, et quand ils virent que rien ne se passait, ils retournèrent sur leurs pas.
Ils étaient artisans cordonniers et faisaient des chaussures sur mesure.
Peu de jours après la fin de la guerre, les réfugiés en direction de la France étaient passés avec un avertissement préalable de ma part et ma mère vint me chercher à pied, passant pour les montagnes, elle, seule, car mon père n'aurait pas pu sortir du pays, Il n'aurait même pas pu aller jusqu'à Prats de Mollo. Je pris le train de Paris en direction de Prats où je retrouvais ma mère. Quel bonheur! Et, le sac au dos, nous rebroussions chemin, et enfin nous arrivions chez nous, à Camprodon. J'avais un frère et cette nuit-là, aucun de nous deux ne pu fermer l'œil, nous nous racontions toutes les choses qui nous étaient arrivées…Ce fut une nuit de confidences.
Entre toutes les bizarreries que je pus écouter cette nuit, il y en a une qui dit que, pendant le régime Républicain, ils ont fait disparaître tous les noms de villages qui commençaient par "Saint" comme Saint Jean, Sainte Maria…Ils furent changés parce que le sentiment religieux n'existait pas. Ils brûlèrent les églises, il n'y avait plus de messe et les enterrements et les mariages étaient laïques. Certains d'entre eux furent même très choquants, par exemple pour Saint Joseph de la montagne, ils n'ont rien trouvé de mieux à dire que "Pépé l'Alpiniste", pour Saint André, L'harmonie du Pigeonnier, et j'en passe.
Quelques mois après la fin de la guerre, je rentrais au service militaire. Je dus servir quelques mois La Corogne, puis, puis on changea tous les catalans vers d'autres endroits, avec des postes d'employés de bureau puisque les casernes avaient besoin de ce type de personnel. Pour moi, ce fut León, où je suis enté directement comme employé aux écritures, dans les bureaux de la compagnie. Je commençais alors à jouer dans l'équipe de football militaire et de là je passais à jouer pour la Cultural de Léon de deuxième division.
Par malheur, une nouvelle étape très dure commençait, la souffrance, l'après-guerre.
Comme Franco n'était pas très bien vu par les nations étrangères, l'Espagne resta bloquée, et pour cause arriva la carence de tous types de produits et ce fut la raison pour laquelle commença le rationnement.
Tout, absolument tout était rationné. Le pain, et tous types d'aliments basiques, le tabac…
Les gens alors se dédiaient à un travail qui rapidement eut un nom: "le marché noir ‘’.
Il manquait de tout et pour cela, il y avait des gens qui gagnaient leur vie en courant dans les montagnes, cherchant dans les maisons ou fermes rurales des aliments qu'ils pouvaient acheter (pommes de terre, bétail, légume et même de la farine), ils redescendaient à la ville en cachette et vendaient à des prix abusifs à ceux qui pouvaient se le payer, qui se croyaient chanceux de pouvoir le faire, puisque la faim et l'appétit touchaient de nombreux foyers. Même les plus malheureux couraient chercher dans les poubelles le moindre morceau de pelure de patate ou n'importe quelle chose comestible afin de pouvoir la manger.
C'étaient des temps durs. L'essence aussi manquait, elle ne venait plus de nulle part. Les voitures étaient équipées avec des appareils dans leurs coffres qui s'appelaient "Gazomètre" qui s'alimentaient de bois et avec la combustion et la vapeur produite ils pouvaient mettre en marche les moteurs. Mais ce ne fut jamais une chose simple!
Il manquait également du coton, chose qui faisait mal tourner les fabricants et par effet ricochet, tous les ouvriers de ces usines. Les vêtements augmentèrent significativement de prix et il n'y avait pas beaucoup de choix et de variété.
Ensuite, c'est la Seconde Guerre Mondiale qui éclata et donc aussi, la peur que l'Espagne entre dans le conflit se faisait très manifeste. Chose qui n'arriva pas, bien que nous eussions toutes les chances de notre côté pour que ce malheur nous arrive.
Une division fut créée, la division “bleue" constituée de volontaires afin de lutter avec les Allemands contre la Russie. Volontaires…Certains disaient qu'il n'en était rien! Moi, je faisais mon service militaire, comme je l'ai dit avant et, j'ai pu observer qu'on nous demandait si nous voulions partir volontairement mais personne ne voulait partir. "Trois hommes" de mon régiment se sont portés volontaires. J'en ai la preuve, et la certitude qu'il n'y en avait pas un de plus, puisque c'était moi qui confectionnais la liste.
Les soldats mangeaient, et, plus ou moins, il n'y avait pas de plaintes. Moi, je mangeais encore plus que les autres étant donné que je faisais part de l'équipe de football du régiment et, en tant que sportif, il fallait nous maintenir en forme et l’on nous alimentait très bien! Et en plus, il fallait compter la nourriture de la troupe! Nous étions suralimentés!
Et c'est ainsi que j'ai terminé mon service, en jouant au foot et rédigeant les écritures de la compagnie. Ce qui signale bien que pour moi l'armée ne fut pas un traumatisme comme elle peut l'être pour d'autres. Pour moi, ce fut simplement une perte de temps.
Une fois le service terminé, je pus commencer à travailler dans l'atelier de Fréderic Mares, après avoir seulement passé un cours à l'école des Beaux Arts, de laquelle il était directeur et professeur.
Ce fut réellement le début de ma carrière, cependant, ce fut à travers la sculpture et non dans la peinture comme j'ai terminé. Pour la raison citée précédemment, mon frère était un très bon peintre et, pour ne pas avoir la même profession que lui, j'ai choisi la sculpture, chose qui ne me déplaisait guère. Je suis resté dans l'atelier Fréderic Mares plusieurs années. Une des choses que je fis, fut le moulage de la sculpture équestre du Général Prim, actuellement au parc de la Ciutadella à Barcelone. En même temps, je préparais une exposition de peintures pour mon frère, cependant, de façon tout à fait inattendue, il est tombé gravement malade et, peu de temps après, il mourut. Il avait 25 ans. Il n'a pas pu voir son rêve se réaliser, une exposition à Barcelone. Moi, en son honneur, je l'ai fait, avec mes peintures.
Monsieur Mares vint me chercher à Camprodon parce qu'il ne voulait pas que j'y reste. Je retournais alors, une autre fois, à Barcelone et Monsieur Mares voulut que je présente quelques-uns de mes dessins, au concours du Cercle Royal Artistique. Je suivis ses conseils et, par chance, je remportais le premier prix. 3000 Pesetas, somme, qui en cette époque, représentait une fortune!
Quand j'ai reçu l'argent, je l'ai totalement dépensé en achetant des peintures, chevalets, toiles et couleurs. Avec tout cela, je suis allé voir Monsieur Mares pour lui annoncer que je quittais l'atelier, que je voulais faire une exposition et que j'avais déjà louè la salle. Et que l'exposition serait de peinture. Il me dit qu'il s'était toujours demandé si au fond, je n'étais pas plus peintre que sculpteur et m'encourageât dans ma lancée.
Je n'avais pas un seul tableau. Je retournais à Camprodon et je me mis à travailler comme un fou, j'ai passé beaucoup de mauvais moments, parce que, entre ce que j'imaginais et ce qui se retrouvait sur la toile, il y avait une grande différence. Mais, finalement, j'y suis parvenu et, en février 1949, on inaugurait à la salle Rovira ma première exposition, individuelle. Avec la présentation de l'éminent peintre et critique Josep Maria de Sucre.
"Le témoignage d'un ARTISTE"
Meritxell Vilar